
Petite voix s'élevant vers Dieu, Thérèse exprimait sa foi ardente dans un quotidien ascétique. Elle qui écrivait que « la joie intérieure réside au plus intime de l'âme […] ; on peut aussi bien la posséder dans une obscure prison que dans un palais », se verra élever en 1937, une basilique aux dimensions et au décorum démesurés.
Thérèse de Lisieux, la « petite voie »
Thérèse de Lisieux, considérée comme la plus grande sainte du XIXe siècle par Pie XI, n'a pas fait de miracle ni vu la Vierge. Son titre de gloire consiste en une sainteté mineure mais humaine : elle a « élaboré » la « petite voie », c'est-à-dire un chemin vers Dieu et la sainteté consistant en une discipline modeste mais systématique, basée non sur l'héroïsme mais sur un engagement quotidien.

Celui-ci est exposé dans les trois petits cahiers d'écolier qu'elle a remplis de sa main au carmel de Lisieux, où elle entre en 1888, à l'âge de 15 ans. Intitulé Histoire d'une âme, il connaîtra une diffusion planétaire dans la version « arrangée » par les soeurs de Thérèse, elles-mêmes carmélites.
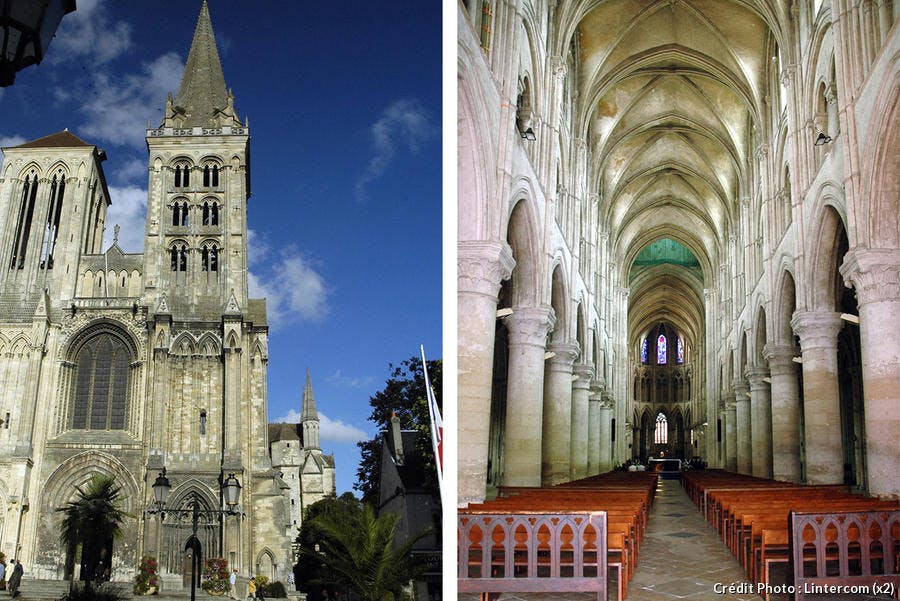
Malade de tuberculose, Thérèse décède à 24 ans, en 1897, mais son message se diffuse dans le monde entier. En 1908, un miracle à Lisieux, la guérison d'une jeune aveugle, accroît l'audience de la ville. Thérèse est béatifiée en 1923, canonisée en 1925 et élevée au rang de docteur de l'Église en 1997. Elle est aussi patronne secondaire de la France, après la Vierge.
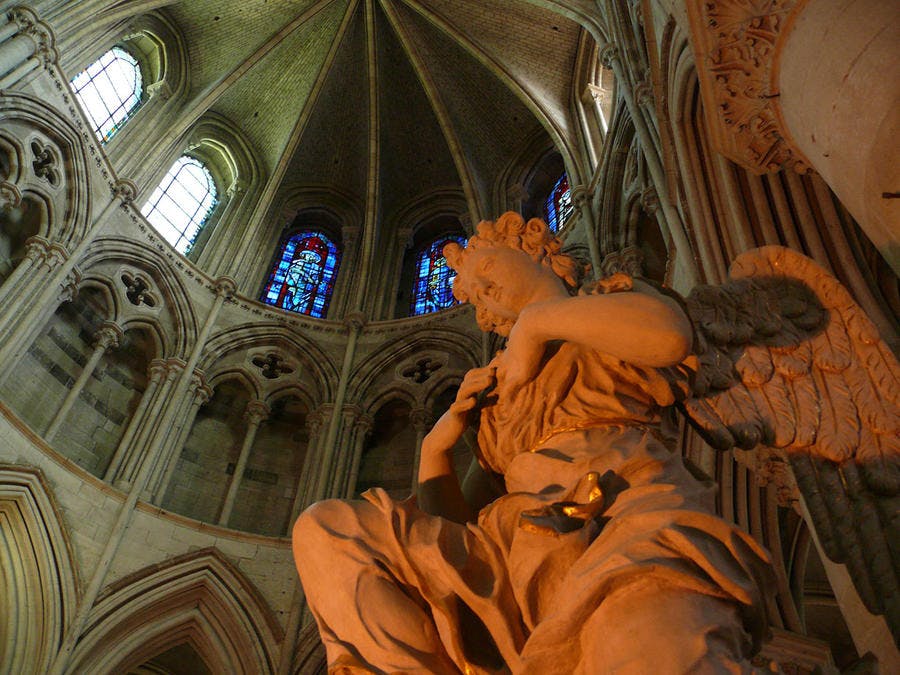
Dotée en 1937 d'une colossale basilique, Lisieux attire des pèlerins en nombre grandissant. Ils étaient plus de 200 000 en 1923, lors de la béatification. La destruction quasi totale de la ville lors des bombardements de 1944 porte un coup au tourisme, mais pas au voyage cultuel : on dénombre 850 000 pèlerins en 2011, dont 175 000 étrangers
Saintes-Maries-de-la-Mer
Avec son cortège de carrioles, ses cavaliers, ses bateaux enguirlandés, le pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer est l'un des plus colorés de France. C'est aussi l'un des plus politiques, et son évolution est un indice de l'intégration de la communauté gitane.

Moins connu que le grand pèlerinage des Gitans des 24 et 25 mai aux Saintes-Maries-de-la-Mer, le pèlerinage du troisième week-end d'octobre réunit les gens du pays. Sortie des châsses, procession de la mer et évocation de l'arrivée des Saintes à la nuit tombante en constituent les temps forts.
Sur ce littoral provençal où les saintes Marie auraient miraculeusement abordé en provenance de Palestine, une autre femme se mêle au groupe : Sara, la servante noire. C'est elle qui est vénérée par les Gitans, mais le pèlerinage officiel des 24 et 25 mai s'intéresse plutôt aux autres : Marie Jacobé (soeur de la Vierge) et Marie Salomé (mère de Jean et Jacques le Majeur), surtout à partir de la découverte des reliques des deux femmes, à la suite de fouilles ordonnées par le bon roi René, en 1448.

Les Gitans, eux, ne peuvent que révérer la châsse de leur patronne dans la crypte, en y entrant par une porte dérobée. Jusqu'en 1935… À cette date, le combat de Folco de Baroncelli (1869-1943) porte ses fruits. Ce personnage haut en couleur, descendant d'une ancienne noblesse toscane, ami de Frédéric Mistral et de Buffalo Bill, éleveur émérite et défenseur de la course camarguaise, est l'artisan d'une petite révolution.

Sara peut enfin être emmenée, comme les saintes Marie, vers le rivage (le 24 après-midi), et cette translation bénéficie désormais de la bénédiction de l'évêque d'Aix-en-Provence.

