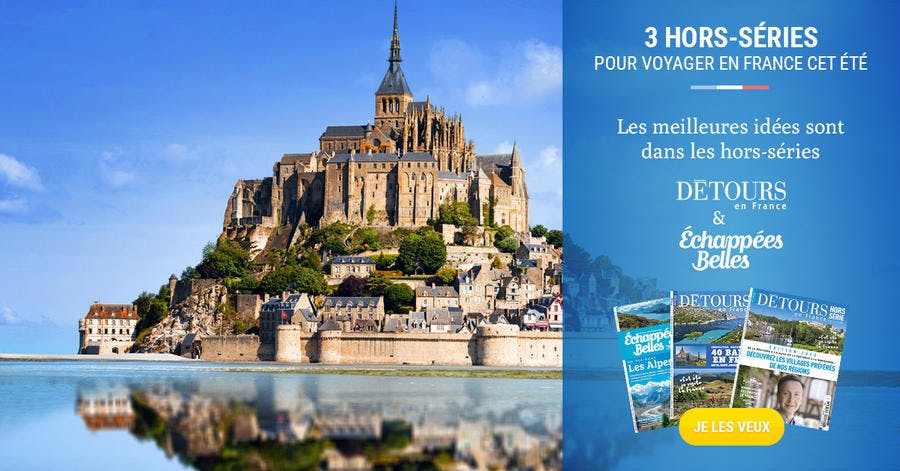Nul château, abbaye ou musée pour séduire le visiteur, juste un village alsacien, dans tout l'éclat de son authenticité affirmée. Hunspach a le charme sincère, pas du tout racoleur. Son plan est facile à dessiner : la rue Principale, une artère parallèle, la rue des Vosges, et quelques chemins de traverse entre les deux, aux noms bucoliques, rue des Moutons, rue des Champs, rue du Moulin et même une rue de l'Ange. Impossible de s'y perdre ? À voir : le village présente une telle unité architecturale qu'il peut être difficile d'y trouver ses repères !
Découvrez aussi :
- Le village qui a décroché la deuxième place du podium 2020 : Les Anses-d'Arlet : toute la douceur des îles
- La troisième place du podium : Ménerbes : la passion Lubéron
Rayé de la carte en 1633

Imaginez des rues larges, taillées à angle presque droit, obéissant à une logique, sinon militaire, du moins de l'Est. Les maisons sont cossues, coiffées de lourdes toitures à pans coupés. Aux couleurs éclatantes qu'arborent leurs homologues de la route des vins, elles préfèrent se parer de crépi blanc ; le seul maquillage autorisé ici est le colombage brun rouge ou noir, qui ponctue les façades, comme les lourds volets de bois (quelques-unes osent le vert, mais elles sont rares). Et partout, des géraniums pour souligner le bord des fenêtres. À les regarder, elles paraissent donc toutes soeurs, voire jumelles, conçues par le même architecte, presque dupliquées à l'infini. À croire qu'elles sont l'oeuvre de lutins facétieux, tout droit sortis de la forêt de Haguenau ! Qu'a-t-il bien pu se passer pour qu'Hunspach affiche une telle homogénéité dans son architecture ? Son destin est étonnant, même si son histoire reste plutôt anonyme jusqu'au XVIIe siècle. On trouve tout juste une mention de son existence dans un texte du XIIIe siècle.
Découvrez aussi notre top des plus beaux villages d'Alsace.
Quand survient la Réforme, Hunspach devient protestant, comme l'Alsace. Pendant la guerre de Trente Ans, tous les belligérants de ce conflit européen passent par l'Alsace et y commettent des exactions. Cela vaut à Hunspach d'être rayé de la carte, ses maisons entièrement rasées par les troupes catholiques en 1633. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que Louis XIV décide de faire rebâtir le village, bien décidé à repeupler l'Alsace. Hunspach devient une ville nouvelle, avec de nouveaux habitants, pour la plupart venus… de Suisse ! Ceci explique sans doute cela, l'ordonnancement symétrique des rues et des maisons. Leur période de reconstruction court du début du XVIIIe à la fin du XIXe siècle. Quelquefois, une date est d'ailleurs mentionnée sur la façade, accompagnée du nom du propriétaire.
De typiques maisons alsaciennes

À bien y regarder, certaines sont quand même plus cossues que d'autres. De grosses fermes articulées autour d'une cour, propriétés des riches paysans du XIXe siècle, occupent le centre du village. L'entrée dans la maison se fait par une porte latérale, et la pièce de vie donne sur la rue. En périphérie du village, l'habitat se fait plus modeste : c'est là que résidaient les ouvriers agricoles. Quand l'ensemble est aussi rassurant à force d'être homogène, on peut se concentrer sur les détails, qui deviennent tout le sel de la visite ! Ici, remarquez un coq de faîtage, des tuiles à bout arrondi, dites « à queue de castor », là un pignon orné de losanges, plus loin une enseigne traditionnelle qui signale l'existence d'une auberge ou de gîtes chez l'habitant.

Regardez bien ces fenêtres : leurs vitres ne vous paraissent-elles pas étranges ? En fait leurs verres – anciens – sont bombés : une technique astucieuse d'autrefois, pour voir ce qui se passait dans la rue, sans être vu ! Et plus besoin de rideau… Rue de l'Ange, une curieuse façade attire l'oeil, ornée de rectangles blancs percés de trous, semblables des dés à jouer. Il s'agit de l'arrière d'une porcherie, dont les ouvertures dans le mur servent d'aération. Rue de la Gare, un puits à balancier, ici appelé schwenkelbrunnen, d'un modèle peu courant en Alsace, avec un système de contrepoids et une auge en pierre qui servait d'abreuvoir aux bêtes. Autre curiosité du village, qu'on découvre plutôt dans la périphérie, des bancs en grès à deux niveaux. Les femmes se reposaient sur le niveau inférieur et posaient leur panier sur celui du dessus.
La route des vins d'Alsace, vous connaissez ?

Allez jeter un oeil à l'église protestante, construite en 1757, toute simple sous son crépi blanchi à la chaux. Le clocher-tour de style roman, qui date de 1874, a remplacé un clocher en bois.
Le combat d'un ministre
Il voulait construire des murs de béton, « qui coûtent moins cher que des murs de poitrines », aimait-il à dire. Pour avoir fait la guerre en 1914 – comme simple soldat, alors qu'il était déjà sous-secrétaire d'État – André Maginot en connaissait le prix. C'est donc par souci d'humanité que ce petit-fils de Lorrain, plusieurs fois ministre de la Guerre, lança la France dans l'édification de la ligne qui porte son nom. Démarrée dès 1928, elle devait protéger l'Alsace du nord au sud sur 200 kilomètres, face à la ligne Siegfried du côté allemand. André Maginot se battit pour débloquer les fonds nécessaires, mais ne vit pas la fin des travaux : il mourut en 1932 d'une fièvre typhoïde.
Le plus gros ouvrage de la ligne Maginot

Hors village, la rue Principale devient départementale et conduit les visiteurs 3 kilomètres plus à l'ouest à un monument exceptionnel de la région, le fort de Schoenenbourg, le plus grand ouvrage de la ligne Maginot. Construit entre 1931 et 1935, il a aussi été le plus bombardé, puisqu'entre le début de la Seconde Guerre mondiale et l'armistice de juin 1940, il a reçu 50 obus d'une tonne chacun et a lui-même envoyé 17 000 obus. Les Allemands n'ont pas réussi à le prendre, mais l'ont contourné et le fort s'est rendu le 1er juillet, six jours après l'armistice, sur ordre du haut commandement, mais toujours invaincu. L'association des amis de la ligne Maginot d'Alsace a réhabilité cet ouvrage incroyable et a permis qu'il soit ouvert à la visite.

Imaginez 3 kilomètres de galeries reliant huit blocs (infanterie, artillerie, transmission, caserne, etc.) à 30 mètres sous terre, protégés par des murs de béton de plus de 3 mètres d'épaisseur. 630 hommes y vivaient en totale autarcie, comme à bord d'un sous-marin, dans des conditions très dures, souvent plusieurs semaines sans voir le jour. La visite est un peu oppressante, en découvrant les chambres de troupe, où les hommes vivaient à 36, douze couchettes sur trois étages, l'infirmerie, l'antenne radio, la cuisine tout électrique, seul grand luxe de l'ouvrage. Et le plus étonnant, c'est que toutes les machineries fonctionnent encore ! Une visite en tout point passionnante, qui ne s'adresse pas qu'aux fans de l'art militaire. Et qui offre un singulier contraste avec la douceur tranquille qui règne dans les rues si pimpantes de Hunspach !
Découvrez aussi:
Cet été, je visite la France !